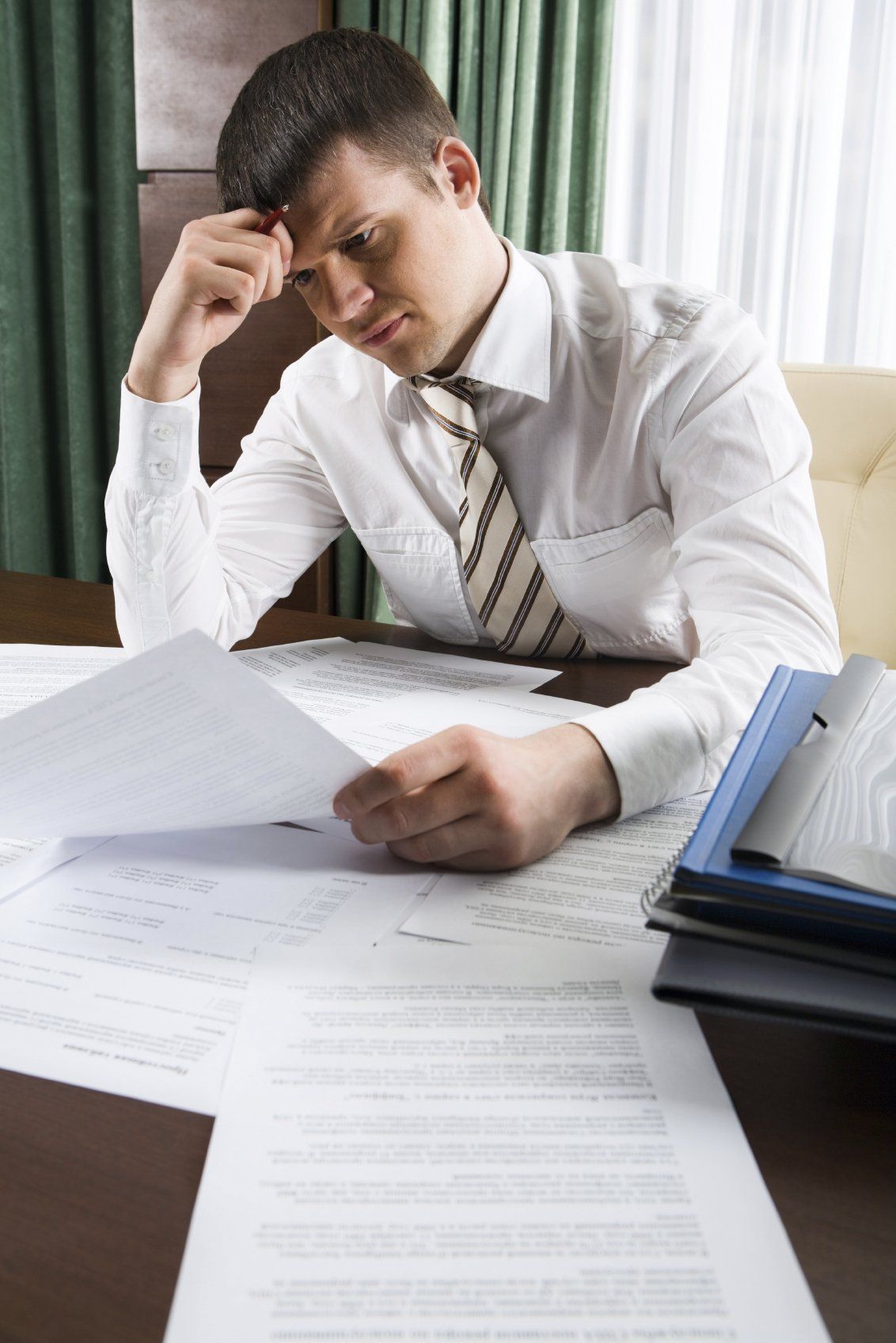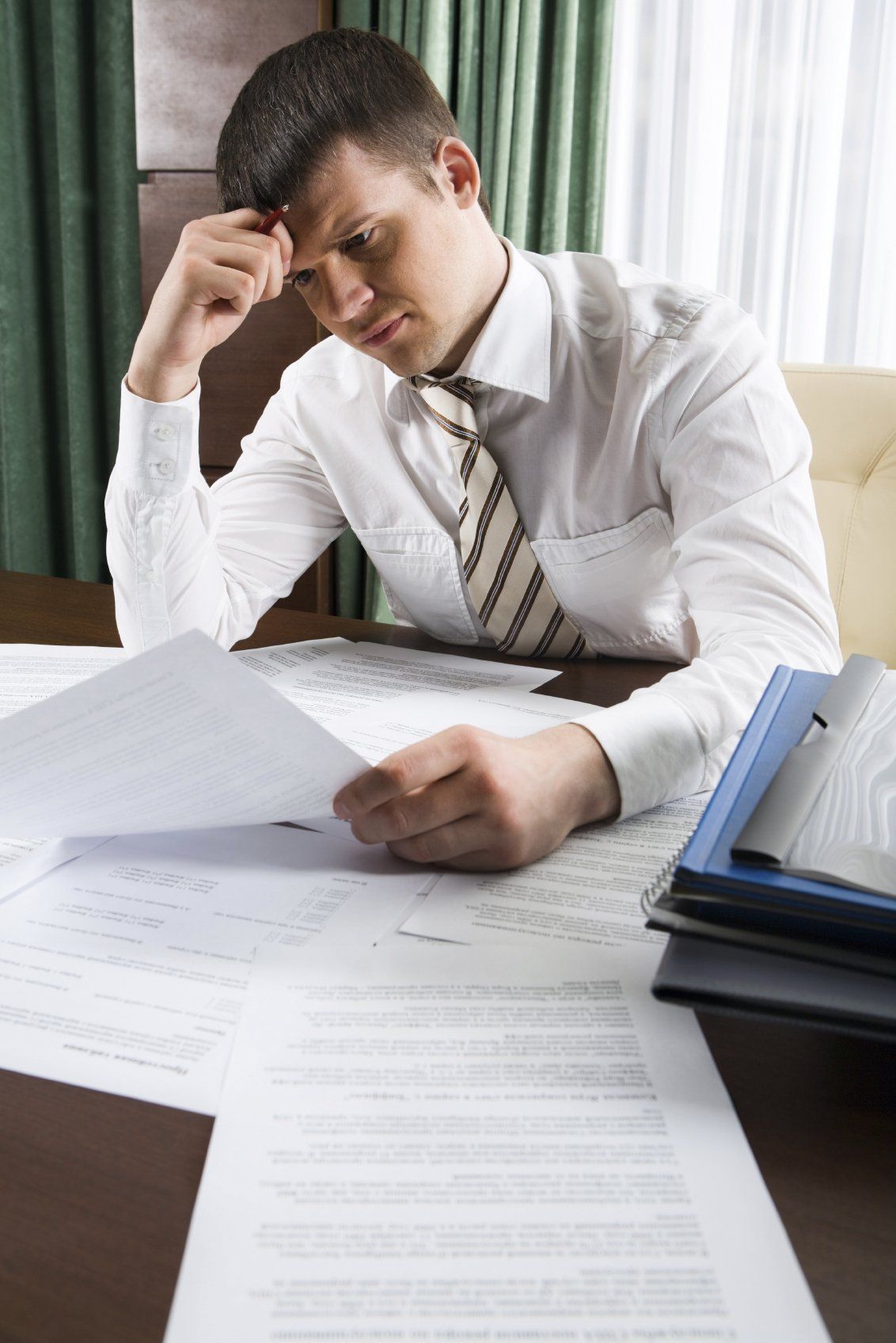La réparation des préjudices nés d'une maladie ou d'un accident imputable au service
Nombreux sont les agents publics qui ignorent qu’ils peuvent obtenir une indemnisation complète de leurs préjudices, même si l’administration n’a commis aucune faute.
Cet article fait le point sur ce droit spécifique, les préjudices concernés, la procédure à suivre et les bonnes pratiques pour maximiser ses chances de succès.
Les agents publics victimes d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie professionnelle peuvent obtenir réparation de leurs préjudices, sans avoir à démontrer une faute de leur administration-employeur. Ce droit, encore méconnu, constitue un atout important pour les fonctionnaires confrontés à des conséquences durables sur leur santé.
Un principe issu de la jurisprudence administrative
Ce droit à réparation autonome a été reconnu par le Conseil d’État dans l’arrêt dit Moya-Caville (CE, 4 juillet 2003, n° 211106). Il permet à un agent victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de l’administration.
Ce régime diffère profondément de celui applicable aux salariés du secteur privé, qui doivent, eux, rapporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur pour espérer obtenir une réparation complémentaire.
Le droit à indemnisation reconnu aux agents publics s’ajoute aux droits statutaires (CITIS, maintien du plein traitement, prise en charge des soins, rente ou allocation d’invalidité éventuelle) et repose sur un régime de responsabilité sans faute (pour risque).
Quels préjudices peuvent être indemnisés ?
En l’absence de faute de l’administration :
Peuvent être indemnisés les préjudices extra-patrimoniaux, tels que :
- Le préjudice moral ;
- Les souffrances physiques et psychiques ;
- Le préjudice d’agrément (impossibilité de pratiquer certaines activités personnelles) ;
- Le préjudice esthétique ;
- Les troubles dans les conditions d’existence ;
- La perte de qualité de vie ou déficit fonctionnel permanent.
Peuvent également être indemnisés les préjudices patrimoniaux autre que la perte de revenus ou l’incidence professionnelle.
En cas de faute de l’administration :
Peuvent également être indemnisés les préjudices patrimoniaux, tels que :
- La perte de revenus ;
- La perte de chance professionnelle ;
- L’obligation de reconversion ou l’abandon de carrière ;
- Les frais médicaux restés à charge.
Cette distinction a notamment été rappelée par le Conseil d’État dans l’arrêt dit Centre hospitalier de Royan (CE, 16 décembre 2013, n° 353798).
Une procédure en deux temps : amiable puis contentieuse
- Phase amiable obligatoire
La procédure débute par une demande écrite adressée à l’administration, précisant les préjudices subis, leur chiffrage et les justificatifs à l’appui.
⚠️ Cette demande délimite strictement le périmètre de l’indemnisation. Tout préjudice non invoqué à ce stade risque de ne pas être indemnisé ultérieurement.
- Phase contentieuse en cas d’échec
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de refus explicite, il est possible de saisir le tribunal administratif. Attention, cette saisine doit se faire dans le strict délai de 2 mois suite au rejet de la demande (implicite après deux mois de silence ou explicite).
En pratique, les administrations acceptent malheureusement rarement de transiger, obligeant souvent les agents à obtenir réparation par la voie judiciaire.
Pourquoi se faire accompagner ?
1. Recourir à un avocat
La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal administratif, mais il est vivement conseillé de consulter un avocat en droit de la fonction publique en amont de la demande pour :
- Identifier les préjudices indemnisables ;
- Évaluer et chiffrer correctement les demandes ;
- Rédiger une requête précise et complète, condition essentielle pour garantir une réparation juste.
2. Consulter un médecin expert
Un avis médical indépendant, émanant d’un médecin expert en réparation du préjudice corporel, peut s’avérer déterminant pour documenter les séquelles et renforcer la crédibilité du dossier.